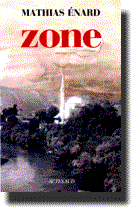 On peut célébrer la mort, le sang, la merde, la violence comme une part avouable de notre être. On peut aussi y plonger sans espoir de salut. Le faut-il ?
On peut célébrer la mort, le sang, la merde, la violence comme une part avouable de notre être. On peut aussi y plonger sans espoir de salut. Le faut-il ?
C'est cette fascination du rouge presque noir qui anime ce long récit. Il nous plonge dans ce que pourrait être la vie d'un agent de renseignements qui, en raison de ses origines et de son goût propre, prend parti et choisir un camp pour y mener sa guerre.
Aucune véritable intrigue ne soutient cette traversée de l'enfer, rythmée seulement par les gares du chemin de fer que le narrateur emprunte pour le conduire à Rome. Est-ce la démonstration que tous les chemins y conduisent ? En revanche, un parallèle s'établit à chaque instant avec des lieux de mémoire où se sont déroulés les événements décrits. Là, rien ne nous est épargné des moments effroyables, mais aussi parfois chaleureux, que provoquent ces révolutions, ces guerres civiles, tribales, raciales où tout, et surtout le pire, est permis : meurtres, viols, massacres gratuits.
Certes, fascination n'est pas approbation, mais cela y ressemble. Or, il me semble qu'une part de notre difficile sagesse de vivre est justement, tout en restant lucides, de ne pas s'appesantir sur nos faces sombres. Bien entendu, elles sont nombreuses, violentes, prégnantes, mais la liberté consiste à faire des choix. Celui du narrateur est l'exemple même, à mes yeux, de cette absence de sagesse.
Le style est original. L'écriture est structurée comme une pensée se déroule : par sauts, analogies, évocations, retours, associations, comme une nuit d'insomnie. Même si, au début, le lecteur n'en lasse une peu, je reconnais qu'on se laisse assez vite porter par le flot de cette pensée inquiète et au fond, assez désespérée. La grande culture de l'auteur donne de nombreux points d'appui pour traverser ce Styx.
Une fresque humaine tragique que l'on quitte sans regret.





 Conception & réalisation
Conception & réalisation