Ce beau et court essai est une réflexion intelligente sur la foi, menée par deux croyants aux approches fort diverses. Ne suivant pas cette voie (les dieux ont-ils oublié de me parler ?), ce livre me concerne-t-il malgré tout ? La réponse est positive, car si la foi est pour moi un mystère dans son concept même, un mystère encore plus opaque est à mes yeux ce qui y conduit. Ce livre est l'occasion d'en débattre, car il est sincère, clair et sans prétention au prosélytisme, une sorte de méditation philosophique sur la foi. De plus, il m'oblige, face aux nombreux points abordés, à me poser la question de ce qu'est ma réponse, formulée ou implicite, qui guide ma conduite. Je choisirai donc quelques sujets traités ici et je tenterai de formuler ma réaction aux questionnements abordés.
Foi et religion
Les deux auteurs récusent les religions "coercitives" pour s'interroger exclusivement sur la foi. Cela me gêne un peu, comme face à un compositeur qui n'étudierait que la théorie musicale sans remplir une partition, sans écrire de musique. Approfondissement d'une sagesse personnelle, certes, mais qui ne suffit pas pour être un honnête homme. Nous sommes des animaux sociaux et attendons de toute pensée qu'elle contribue à donner un "corpus doctrinal", une "règle d'or", à nos relations avec nos semblables, car nous en avons besoin pour la cohésion de nos sociétés. C'est ce complément qu'apportent les religions avec des succès historiques dont certains sont utiles, d'autres néfastes et même criminels. Les auteurs, avec les notions de bien et de beau, tenteront de combler ce vide en précisant une piste d'action sociale dont nous reparlerons.
Finitude de l'homme et de l'univers
Le livre rappelle cette limite et en déduit que notre compréhension du monde ne peut pas être totale, laissant ainsi la place ouverte à des spéculations sur l'origine du tout, sur son unité, etc. Je ne saurai jamais dire à quel point je partage cette idée de finitude et de ses conséquences, mais reste perplexe sur l'ambition de pallier cette insuffisance par des croyances bien établies, qui ne sauraient prétendre à être des vérités. Nous ne constituons qu'une pièce du tout, fini pour nos sens et pour nos représentations de l'univers (l'infini est un outil mathématique, jusqu'ici sans réalité) et notre cerveau, en dépit de ses capacités, trouve certainement une limite à ce qu'il peut saisir et conceptualiser avec l'outil scientifique. Il me semble même que l'absence depuis 100 ans de percée conceptuelle sur notre univers ( les dernières étant relativité et mécanique quantique) tend à faire craindre que nous nous essoufflions dans la progression de notre représentation humaine du monde accessible à notre entendement. Ce qui n'empêche pas de rêver d'univers parallèles ou de dieux bons et tout puissants, sans que ces spéculations, pour autant, permettent de dégager des vérités universelles. Elles fourbissent même les ingrédients de la division et de la haine, lorsque, comme le font certains monothéismes, elles prétendent à l'universel dans la lutte pour la prééminence de leurs fantasmes divins.
La beauté
L'un des auteurs invoque ce concept comme un guide de notre voie d'hommes. Je partage tout à fait cette sagesse et comprends cette recherche du beau comme un des piliers de l'équilibre de la vie. Pourquoi ? La sensation de beauté est l'atteinte par nos sens et notre esprit d'une harmonie avec le monde réel. Nous ne sommes plus un spectateur, mais une corde vibrante du grand instrument qu'est le monde, réduisant par cette intégration le risque d'un dérapage individualiste hors de la réalité. Oui, la beauté contribue à nous guider et nous avons, dans nos actes, un devoir de beauté. Mais, bien entendu, cela ne suffit pas à la conduite d'une vie.
Le bien, le mal
Ce sujet est délicat, car les concepts de bien et de mal sont indéfinissables et les hommes ont, au cours de l'histoire, montré qu'ils en avaient des compréhensions différentes. Si donc il en est ainsi, si le bien et le mal sont des données locales, communautaires et donc non universelles et que le bien que je fais ici est considéré ailleurs comme un mal, voici un guide bien bancal, qui me conduit à nouveau aux confrontations, à la haine, à la guerre. Messieurs Zelensky et Poutine font, l'un et l'autre, un bien local. Faudrait-il que l'un fasse le mal pour retrouver la paix ? C'est en réponse à cette impasse que l'usage de la loi s'est imposé, loi souvent fragile, élaborée à chaque niveau de structure de la communauté humaine et qui permet de dire que le bien est le respect de la loi et le mal son contraire, mais laisse ce qui est non prévu par les lois, dans l'incertain. Ce fut, en son temps, un des apports des religions de tenter d'y remédier localement, mais par des voies "coercitives", non démocratiques. Quant aux éléments universellement partagés par les différentes communautés sur le sens de bien et mal, il me paraît si restreint et si fragile qu'il n'a pas la valeur souveraine qu'on en attend. La voie me semble donc très encombrée et je crains fort que la foi, génératrice d'absolus personnels et au mieux (ou au pire ?) locaux soit plus un handicap qu'une aide.
L'unité ontologique de l'univers
Unité ? Quelle unité et pourquoi une telle unité existerait elle ? Sur quels faits se fonde cette attente d'unité ? Au contraire, dans la limite de ce que je comprends, tout m'incite à penser que je suis au milieu d'un tourbillon de diversité, de naissance et de mort, d'adaptation au changement aux succès variables, sans prévisibilité bien ferme, une situation qui durera jusqu'à ce que notre astre solaire s'éteigne. Pourtant, une question peut rejoindre cette quête, c'est celle du pourquoi de l'unité des lois physiques qui, jusqu'à preuve du contraire, gouvernent tout ce que nous connaissons de l'univers. La réponse scientifique actuelle, soumise à vérification par les pairs et susceptible de dépassement, est que ces lois, comme les variables que nous mesurons, résultent de la fluctuation du vide nommée "Big Bang" qui n'est en rien une création. Nous sommes donc parties d'un seul univers avec son paquet de lois et de données, univers qui, lui seul, est accessible à notre entendement. Le reste, inaccessible à tout contact, est source de spéculations sans vérification possible. Je suis, pour ma part, extrêmement prudent sur celles-ci, car elles me semblent plutôt des facteurs de division que d'unité des hommes, sans fournir de réponses opératoires.
Croire ou non ?
Nous pourrions continuer une approche similaire sur les autres points, mais il est évident que nous tournons autour d'un profond désaccord de fond sur la valeur des croyances, sans que cela retire à mes yeux une parcelle de dignité ou de respectabilité à ceux qui la portent au fond d'eux-mêmes lorsqu'ils sont sincères et à la recherche d'une sagesse privée. Mais la communauté humaine est fragile, prompte à l'éclatement et à la division, particulièrement de nos jours où le populisme et son attitude antirationnelle croissent. Elle a donc besoin de retrouver des valeurs partagées. Et ce ne sont pas les croyances des uns et des autres, toujours partielles, locales (mais absolues !) qui apporteront remède, car elles resteront ce qu'elles sont, des vérités pour certains et des illusions mensongères pour d'autres et donc des facteurs de division. Il me semble plutôt que les hommes doivent se réunir autour de valeurs issues de l'usage de la raison, car c'est la seule activité humaine partageable entre tous et qui fournit une méthode d'essai et d'accumulation d'expérience jusqu'ici indépassable et dont l'activité scientifique est une de ses progénitures, mais pas la seule. Le monde entier partage la compréhension et les fruits de cette méthode, sans coercition. Le reste, qu'elle ne couvre pas, et qui est immense, est un choix personnel, dont la matière est fournie par nos gènes et notre expérience et terriblement difficile à partager autrement que par l'élaboration de lois qui en traitent une partie. Mais, il restera toujours une part individuelle aux choix de notre conduite, ce qu'on appelle liberté, à la fois condition de notre humanité, mais à l'irénisme souvent défaillant. Nous sommes enfermés dans notre univers et particulièrement sur terre et, je le crains autant que je m'en réjouis, obligés d'y rester, portant pour toujours le poids de nos incertitudes et de nos erreurs.
Merci aux auteurs pour ce grand petit livre et son évidente sincérité, mais à la préface rugueuse.
Les Éditions de Paris Max Chaleil (2025), 88 pages

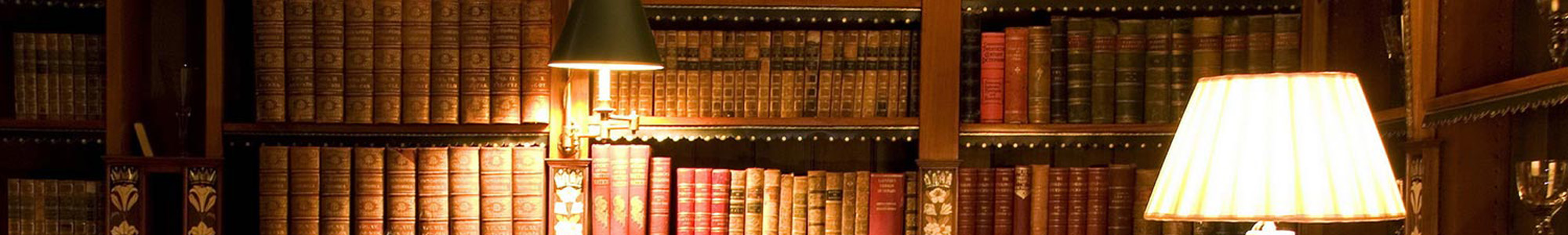


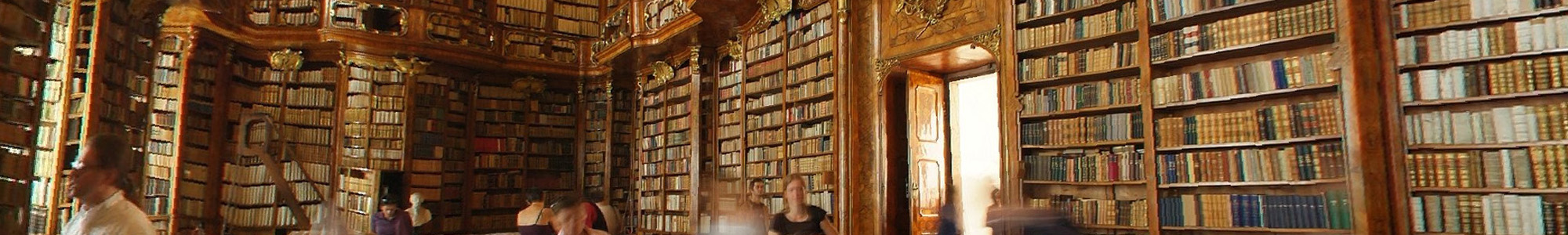

 Conception & réalisation
Conception & réalisation