"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
- Détails
- By livres-et-lectures.com
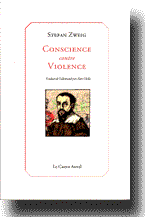
"Avec le temps, la vie s'avère toujours plus forte qu'une doctrine abstraite", nous dit SZ en 1936, face à la montée du national-socialisme totalitaire. Et, quand ici il dit "la vie", c'est à son ingrédient majeur, la liberté de penser, qu'il fait allusion en l'illustrant par la lutte à mort menée par Calvin contre ses contradicteurs.
En effet, il n'y a pas, à ses yeux, de vie bonne sans liberté de penser et liberté de le dire et de l'écrire. Il y voit la dignité de l'homme autant que la condition de son progrès et de son épanouissement. Aucune doctrine, politique, scientifique, religieuse ou autre n'a de valeur absolue ni ne peut ni ne doit, s'exempter du questionnement sur sa validité. Les scientifiques le savent, qui en ont fait leur outil et leur marque distinctive. Les autres en sont loin et lorsqu'ils veulent affirmer la prééminence de leur doctrine, toujours fragile intellectuellement, c'est par le recours à la violence et à la terreur qu'ils peuvent seulement le faire.
- Détails
- By livres-et-lectures.com

SZ tente de répondre à la question que pose le nom "Amérique", nom qui aurait dû être "Colombie", d'après son découvreur historiquement avéré. Erreur historique, dont l'origine n'est pas si simple !
Cette question n'a d'ailleurs pas de réponse définitive et incontestable, mais S Z fait sienne l'hypothèse selon laquelle, à l'insu d'Amérigo Vespucci et de Christophe Colomb (voyageurs contemporains), les éditeurs ont fait passer Vespucci, dont les textes avaient une certaine notoriété, pour le premier à avoir posé le pied sur ce continent, sans doute pour mieux vendre leur production. La thèse est étayée et elle apporte les solutions les plus simples aux questions restées sans réponse jusqu'ici.
Il n'en reste pas moins que, cela semble historiquement confirmé, Amerigo Vespucci a été le premier à affirmer et écrire que la terre nouvellement découverte n'était pas la Chine, mais un "Nouveau Monde" et que, tracer une voie nouvelle vers l'Inde, supposait son contournement maritime. Ce que, en dépit de deux essais ultérieurs, il ne réussira pas à accomplir.
Christophe Colomb, quant à lui, restera persuadé qu'il avait atteint la Chine...
Le style de S Z (et la bonne traduction) nous valent une biographie très réussie de cet Amérigo inconnu ou presque, mais qui aura, de son prénom, et sans l'avoir cherché, fait un étendard dont on n'a pas encore fini de parler.
- Détails
- By livres-et-lectures.com

Cette longue nouvelle, retrouvée par hasard, a tout le charme des analyses psychologiques subtiles de SZ. On la lit d'un trait, pris par la tension du récit. Un bon moment !
Le thème est celui de l'impermanence du monde qui rend les passions et les engagements si fragiles aux yeux des amateurs d'absolu que nous sommes. L'amour, que s'étaient juré Louis et la belle épouse de son bienfaiteur, se dissoudra dans le temps et sortira rongé, déformé, désincarné de l'épreuve de l'absence.
SZ a toujours le même talent de savoir conduire l'intrigue à son climax et de lui trouver une chute qui n'est jamais de circonstance.
On peut et c'est mon cas préférer d'autres romans de SZ, comme "Le Monde d'hier", par exemple, ou ses biographies, comme "Marie-Antoinette" ; celui-ci reste néanmoins un bel exemple de son talent et un bien agréable cadeau pour les lecteurs que nous sommes.
Page 2 sur 3

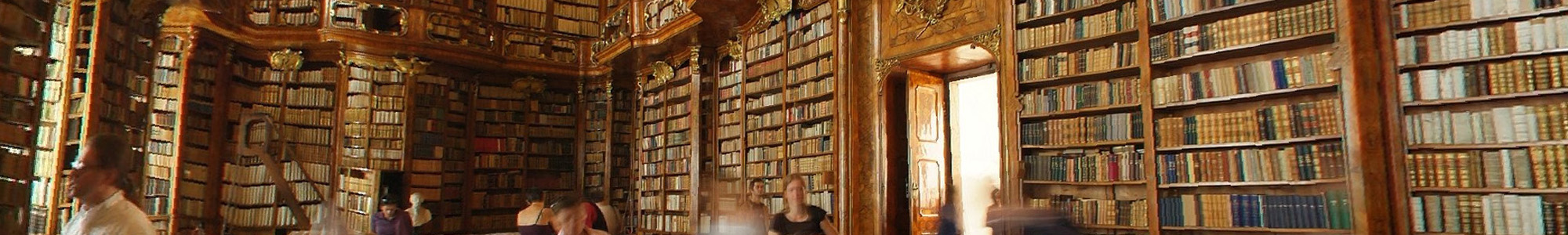

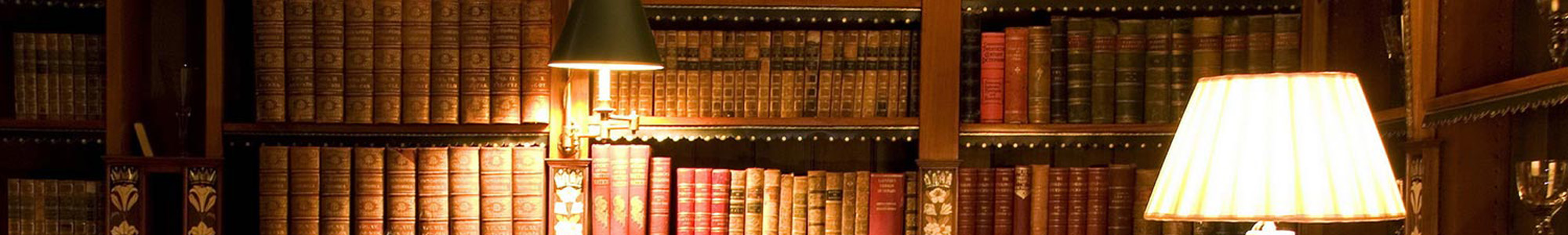

 Conception & réalisation
Conception & réalisation