"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com
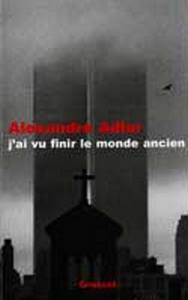
Pour aller vite à l'essentiel, il me semble que la lecture de ce livre devrait être rendue obligatoire dans les chaumières, car il nous donne quelques clés inédites de de la stratégie politique des forces en présence sur l'échiquier mondial. La presse accumule des faits que nous recevons sans grille d'interprétation, et, avouons-le, sans grande culture stratégique du monde, particulièrement de l'Islam et du Moyen-Orient. AA tente ici de nous apporter quelques bases d'interprétation des événements du monde actuel, avec son talent, sa mémoire époustouflante et sa grande connaissance de l'histoire. Ainsi, peu à peu les faits se relient, parfois s'expliquent. Que cela ne suffise pas à prévoir l'avenir est une évidence, si tant est que prévoir, ici, a un sens autre que prendre ses rêves pour la réalité. Et combien différents et conflictuels sont nos rêves...
Lire la suite... Alexandre Adler, J'ai vu finir le monde ancien
- Détails
- By livres-et-lectures.com
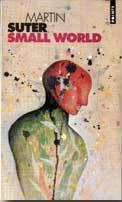
Il s'agit ici d'une intrigue policière qui concerne les sombres secrets d'une famille industrielle suisse opulente. Soit. Mais ce qui fait l'intérêt du livre est que le personnage principal va vivre cette affaire progressivement envahi par la maladie d'Alzheimer dont on peut presque dire qu'elle est elle-même le héros négatif (et pourtant positif en partie) de cette histoire. L'auteur s'est fait aider par des médecins et sa description d'une vie que cette maladie terrible vient détruire est passionnante. En ce qui me concerne, ce roman m'a aidé à comprendre ce que Alzheimer signifie dans la quotidienneté d'une existence humaine. N'est-ce pas utile ?
A cet intérêt très particulier s'ajoute le fait que ce roman est bien écrit, l'intrigue bien menée et qu'il se lit avec l'envie d'aller toujours plus avant. Jamais le fait qu'il traite d'une maladie ne le rend apitoyé ou voyeur. La distance est respectée avec discernement, sans phrases doctorales ni expressions barbares. Le ton est juste, immédiat ; les mots sont simples et directs.
A lire.
- Détails
- By livres-et-lectures.com
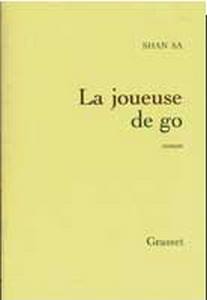 L'auteur a moins de trente ans lorsqu'elle écrit ce roman vif et attachant. Ses qualités lui ont valu le "Goncourt des lycéens" en 2001.
L'auteur a moins de trente ans lorsqu'elle écrit ce roman vif et attachant. Ses qualités lui ont valu le "Goncourt des lycéens" en 2001.
Nous sommes en 1931 en Mandchourie et le Japon, allié d'occasion et impérialiste sous des habits de libérateur, y impose sa loi en attendant de conquérir le reste de la Chine, au mains de Chiang Kai Tchek. La férule japonaise est dure et chacun, occupant ou occupé, cherche à mener sa vie comme il peut et à y préserver un peu d'humanité.
Deux personnages vont alors se rencontrer jusqu'à une fusion dramatique de leurs destins.
Elle est la joueuse de go, jeu où elle excelle, jeune fille mandchoue de seize ans.
Lui, qui la rencontrera devant un go-ban, apprend à l'apprécier et à l'aimer. Union impossible dans son essence, car il est officier japonais. Mais la montée et le dénouement de ce drame nous captivent.
Le style est remarquable de densité, de clarté, construit sur de petites phrases courtes, factuelles, presque dures. Les paragraphes brefs s'enchaînent, où, dans une alternance imperturbable, les deux personnages s'expriment brièvement tour à tour. Une sorte de récitatif à deux voix qui conduit l'action.
Un livre d'une lecture facile et d'un grand charme.
Éditions Grasset 2001
Page 314 sur 336
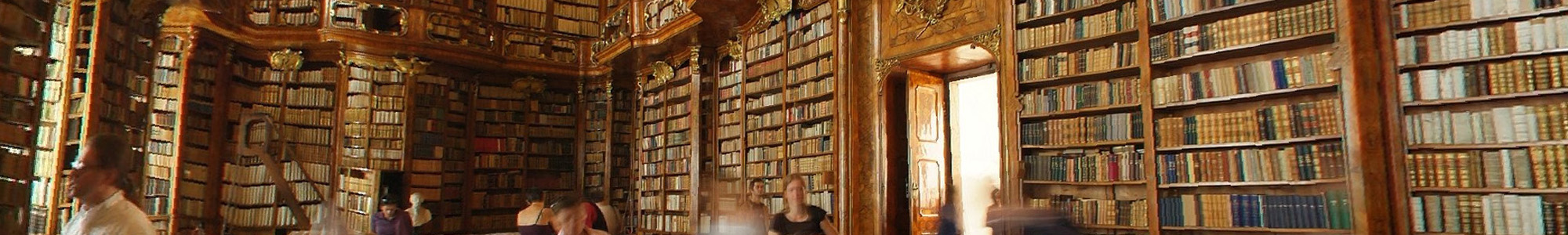



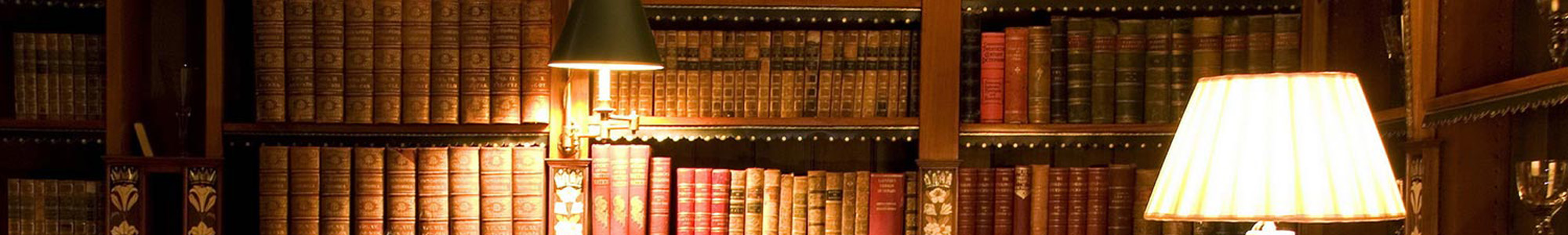
 Conception & réalisation
Conception & réalisation