"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com
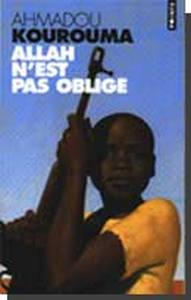 Ce livre raconte l'histoire effroyable d'un enfant-soldat de ces pays perdus d'Afrique, ici le Liberia et la Sierra-Leonne. Non, Allah n'est pas obligé, semble-t-il, d'être juste dans tous ses actes ici-bas. A lire ce livre, on pourrait inverser la proposition et se demander même s'il l'est parfois...
Ce livre raconte l'histoire effroyable d'un enfant-soldat de ces pays perdus d'Afrique, ici le Liberia et la Sierra-Leonne. Non, Allah n'est pas obligé, semble-t-il, d'être juste dans tous ses actes ici-bas. A lire ce livre, on pourrait inverser la proposition et se demander même s'il l'est parfois...
Résumer les violences et les horreurs commises et vécues par cet enfant, c'est énumérer les turpitudes infâmes dans lesquelles s'installe un être ni meilleur, ni pire qu'un autre sans doute, mais dont nul n'a fait l'éducation et que nul n'a aimé pour lui faire percevoir la valeur d'une émotion humaine "chaude". C'est pire qu'une bête car il lui reste le pouvoir d'intelligence et de nuire d'un homme sans aucune référence morale pour se conduire. Que notre univers "développé" comprenne aussi de tels individus est une évidence ; mais, jusqu'ici la société et ses institutions les contrôlent. Là bas, non.
Ce livre démystifie aussi l'image politiquement correcte de ces guérillas africaine, toutes démocratiques et de libération, qui ne sont rien d'autres que les actes de gangsters et de voyous sanguinaires vivant de vols et de violences selon leur bon plaisir.
Peut-être l'auteur force-t-il un peu le trait pour nous faire partager son impuissance et sa rage devant ce gaspillage humain. Mais je n'en suis pas certain. Sans doute règle-t-il aussi certains comptes... Son manque d'indulgence envers la société des chasseurs (classe d'initiation de nombreux pays d'Afrique) fait question, par exemple. Ses personnages, dont pas un seul ne dit "stop" me parait étrange dans cet univers qui a une histoire et une tradition, et cela retire de la crédibilité historique à ce récit. On reste le nez collé dans la boue jusqu'à l'asphyxie.
Enfin le style n'est pas toujours plaisant ; il est même souvent répétitif au delà du nécessaire et donne envie de sauter des lignes...
Un livre de la même veine noire mais qui reste assez en deçà de son "En attendant le vote des bêtes sauvages".
Éditions Points P940 (2000)
- Détails
- By livres-et-lectures.com
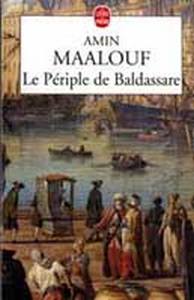
Voici un très beau conte, écrit en 2000, comme Maalouf sait les tourner pour un plaisir, sans doute fugitif, mais réel. Un voyage (des voyages !) dans un fauteuil.
Maalouf écrit bien et c'est sa première vertu. Une attente sans suspense, sans drame grandiloquent, sans sexe provoquant (un peu d'amour, d'ailleurs sans trop d'illusions). Une vie un peu plus active que la notre, à la portée de nos rêves. A ce ton "juste" se mêle souvent une pointe d'humour, distance suffisante entre le récit, son auteur et nous qui allions le croire...
Quant aux voyages, Maalouf nous les sert au coin du feu, pleins de rencontres et d'instants inquiétants. Et comme les vrais voyages, ils ne conduisent jamais notre héros qu'à lui-même, à ce qu'il craint, à ce qu'il croit, à ses doutes et à ses espoirs.
Le fil de tout cela ? Un raisonnable marchand de curiosités génois exilé "en Orient", Baldassare, part en 1665 à la recherche d'un livre aux mille pouvoirs (ceux qu'on lui donne ! ) qui lui a échappé des mains. Il le retrouvera et devenu sage par le truchement de ses aventures, le rangera dans un tiroir. Baldassare personnifie ainsi la raison qui doute, mais agit, dans un monde normal donc un peu fou, caractérisé ici par l'attente déstabilisatrice de l'apocalypse. Il glanera au passage quelques éléments de bonne philosophie.. et quelques amitiés.
Il n'en faut pas plus pour passer quelques heures de grand plaisir.
Éditions Livre de poche 15244 (2000)
- Détails
- By livres-et-lectures.com
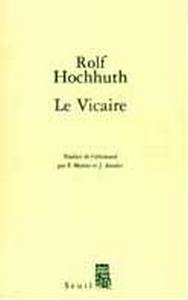
Cette pièce de théâtre, écrite en 1959 est indissociable de nos jour du film de Costa-Gavras, "Amen". On connaît le thème du film : le silence jugé coupable du pape devant le massacre organisé des juifs dans les camps d'extermination nazis. Le livre me paraît avoir une autre portée, qui inclut cette question bien entendu, mais en pose aussi d'autres, plus permanentes et si je peux dire plus profondes sur la condition humaine.
Page 315 sur 335
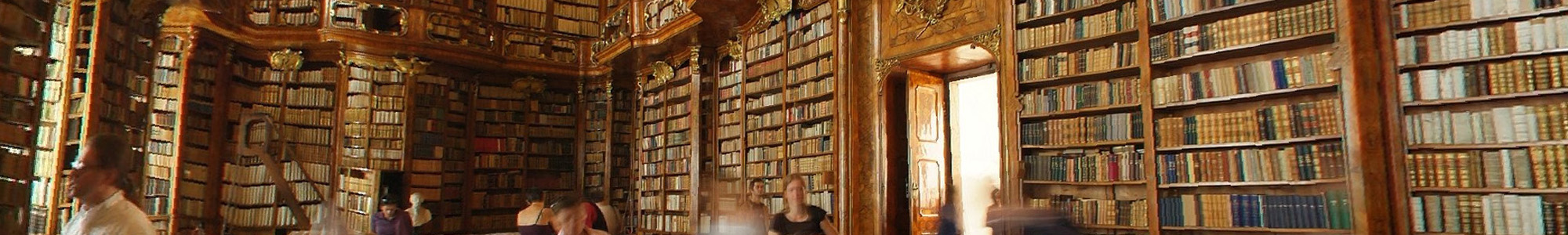



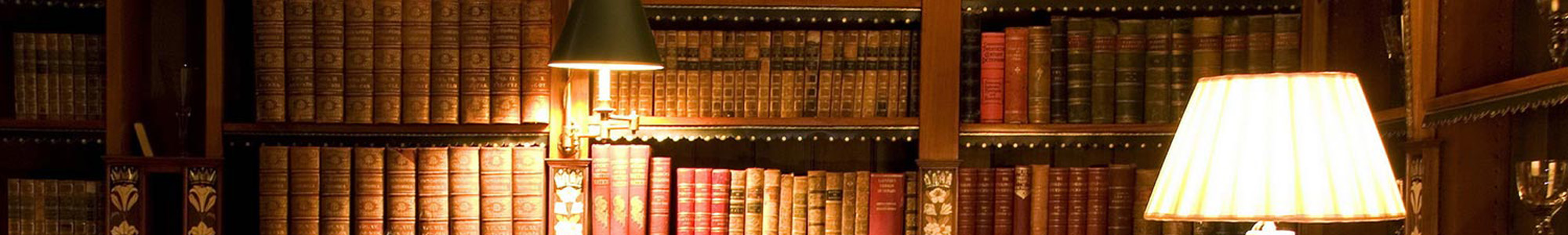
 Conception & réalisation
Conception & réalisation