"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
"Rarum est felix idemque senex" Sénèque
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com

AEA décrit, tel un Balzac du Caire, la société actuelle du pays. Un foisonnement de personnages colorés nous attend, que l'écriture de AEA nous rend attachants, même ceux que notre raison rejette. L'intrigue est un lien entre toutes ces vies blessées et est un prétexte à leur mise en scène. En émerge un tableau de société d'où l'espoir est exclu et qui se réfugie de plus en plus dans une religion devenue folle et dans la violence.
- Détails
- By livres-et-lectures.com
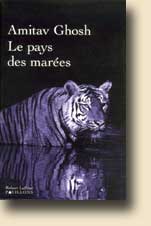
AG est un remarquable conteur indien, par qui c'est un plaisir de se laisser emporter. Les récits mythiques, fondateurs, dont il fait un velours, nous font découvrir cette Inde à la limite du Bangladesh et est le contexte, autant que l'étrange pays des marées, d'une aventure humaniste et optimiste.
- Détails
- By livres-et-lectures.com
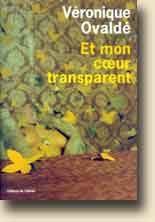
Avec une écriture qui mélange à tout moment pensée et discours, VO nous offre un roman original par la forme et qui se lit facilement et avec plaisir.
Le fond n'a pas, pour moi, la même force. Les espèces humaines qu'on y croise sont des produits vaseux, parfois voyous et toujours jouisseurs, de la société post soixanthuitarde. Qu'il est donc difficile de s'en débarrasser ! Fainéants aux idées généreuses de gamins gâtés, ça boit, ça se drogue, ça rêve de dictateurs politiquement corrects ... et d'un monde impossible, mais désirable à leurs yeux, qu'il faut faire advenir à l'explosif.
Tout ça a le goût des répétitions et ennuie un peu. Il s'y greffe un décès dont l'explication est une pirouette amusante. L'enquête sur cette mort (violente ?) est la trame du roman qui, sans le ton personnel et attachant de VO, ne tiendrait pas. Un bon point, aussi : ce jeu de balançoire permanent entre le réel et le rêve que ce ton traduit si justement.
Un agréable moment de lecture.
Page 239 sur 336

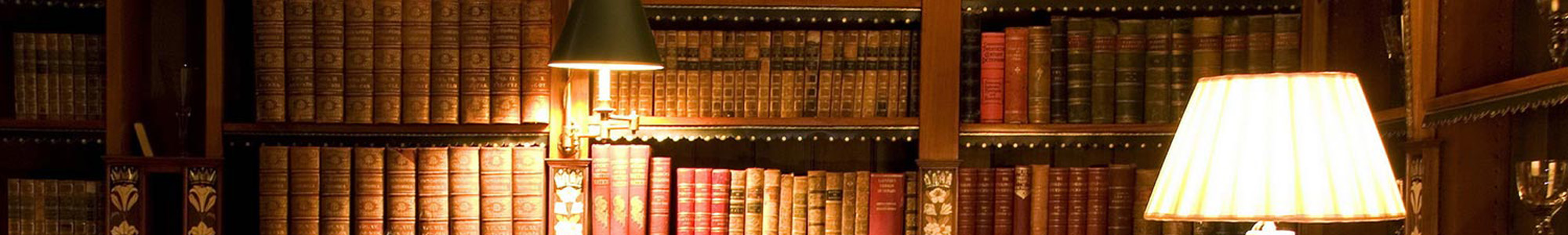


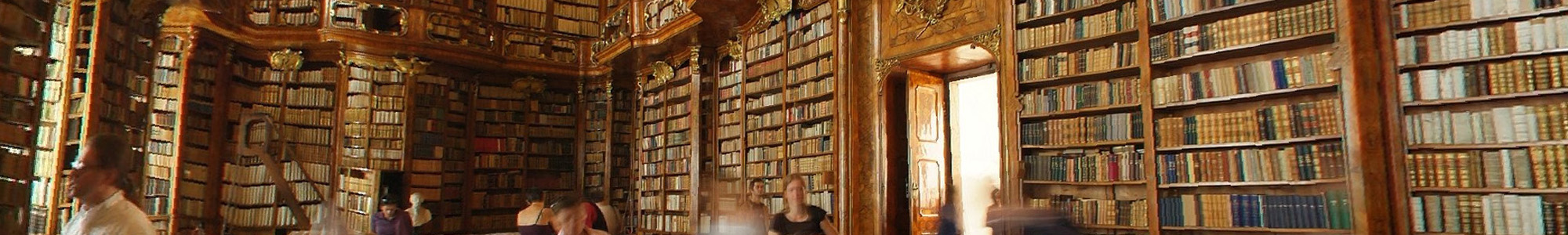
 Conception & réalisation
Conception & réalisation