"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
"Rarum est felix idemque senex" Sénèque
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com

APR est un auteur espagnol, né en 1951 et journaliste d'origine. Il a obtenu un prix de littérature policière pour ce livre en 1993.
Cette distinction me paraît tout à fait heureuse, car cette histoire d'escroquerie à l'assurance est remarquablement menée du début à la fin. C'est de plus un livre intelligent qui entrelace une partie d'échec et une plongée dans les dits et les non-dits de la peinture d'une façon magistrale et tout à fait originale. Ici, jamais de recours aux excès délicieux et commerciaux du sexe et de la violence, tout au plus à la manière voilée d'A. Christie.
Aucun des personnages ne va sortir blanc de cette aventure, mais les portraits qui défilent valent le voyage.
Croit-on vraiment à cette intrigue complexe et très "psychologique" ? Assez en tous cas pour passer un bon moment. C'est déjà bien ...
Cette distinction me paraît tout à fait heureuse, car cette histoire d'escroquerie à l'assurance est remarquablement menée du début à la fin. C'est de plus un livre intelligent qui entrelace une partie d'échec et une plongée dans les dits et les non-dits de la peinture d'une façon magistrale et tout à fait originale. Ici, jamais de recours aux excès délicieux et commerciaux du sexe et de la violence, tout au plus à la manière voilée d'A. Christie.
Aucun des personnages ne va sortir blanc de cette aventure, mais les portraits qui défilent valent le voyage.
Croit-on vraiment à cette intrigue complexe et très "psychologique" ? Assez en tous cas pour passer un bon moment. C'est déjà bien ...
Editions Livre de poche 7625 (1990)
- Détails
- By livres-et-lectures.com
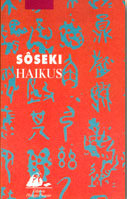
Un haikai est un tout petit outil poétique qui tente d'exprimer dans un éclair allusif plus que ne peuvent signifier les mots qui le composent, plus que ce que les mots ne portent dans leur valeur d'échange. Un peu de ce que nous sentons confusément bouillonner en nous, vaste et inexprimable, confus et si fort. Et tout cela en 17 syllabes, 5-7-5.
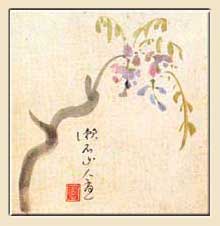
Emoussée la lame
Qui fend la pierre de riz
Emoussée l'année
Journée de printemps qui s'étire
Un baillement entraîne l'autre
Deux amis se quittent
Soseki est un romancier (1867 - 1916) qui continue à être lu, et pas seulement au Japon et à être aimé. Je conserve le souvenir très vif d'un superbe roman "Je suis un chat", ou de "Botchan", par exemple. Mais ici, ce qu'il nous offre est plus intime, plus personnel. Une vraie réussite.
De plus, le livre est magnifiquement mis en page, avec des peintures de l'auteur. Un régal !
De plus, le livre est magnifiquement mis en page, avec des peintures de l'auteur. Un régal !
Editions Philippe Picquier (2001)
- Détails
- By livres-et-lectures.com
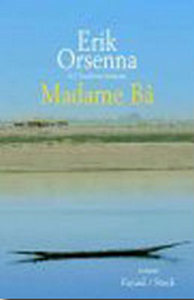
Etes-vous un peu poètes, c'est a dire capable d'aller un peu peu plus loin que le plaisir du sens où la musique des mots ? Sans cela, comme moi au début de ce roman, vous passerez souvent à côté de bien des bons moments que réserve ce livre. Mais rassurez-vous. Vous ne pourrez pas échapper à son charme, si l'on peut dire, pédagogique. Madame Bâ, d'ailleurs fait profession d'apprendre. Elle nous apprend ici l'Afrique et, au delà, une part bien oubliée et enfuie de nous mêmes.
Son scribe, un jeune avocat blanc qui prend sous sa dictée sa lettre au Président de notre République pour obtenir un visa de court séjour, nous dit tout : "Je suis un homme économique, madame Bâ, ... morcelé en dossiers et en hobbies, en heures et en minutes ... Je suis un amas de rondelles. Vous me réapprenez l'unité". Madame Bâ est ce que l'Afrique produit encore, des êtres dont le coeur et la tête font toujours bon ménage, enfin dans leur meilleur avatar. Unité aussi de soi et du monde, pour le meilleur et pour le pire. C'est un beau voyage de découverte de l'Afrique et du Mali qui nous est offert là.
Mais c'est aussi un voyage dans l'Afrique qui perd sa boussole, qui a perdu ses lois et sa structure et se demande avec angoisse si elle a les moyens d'en acquérir d'autres. Les modèles qu'elle voit autour d'elle ne sont pas très convaincants. Lisez par exemple l'affaire de l'échangeur, une de ces escroqueries couvertes par l'aide au développement. Ou l'affaire des "ogres".
Bien sûr, ce n'est qu'un roman et un très bon, mais il me laisse partagé. Cette compassion qu'il exprime est certainement la clé de toute tentative de rapprochement, d'aide véritable. Et que l'on balaie au passage dans notre propre cour. Mais il nous livre peu de clés pour ouvrir de nouvelles portes. Car celles dont nous disposons, tant le Mali et l'Afrique que nous même, ont échoué. Alors, s'en remettre au sort ? Ne reste-t-il que l'exil, comme semble le conclure ce livre ?
Son scribe, un jeune avocat blanc qui prend sous sa dictée sa lettre au Président de notre République pour obtenir un visa de court séjour, nous dit tout : "Je suis un homme économique, madame Bâ, ... morcelé en dossiers et en hobbies, en heures et en minutes ... Je suis un amas de rondelles. Vous me réapprenez l'unité". Madame Bâ est ce que l'Afrique produit encore, des êtres dont le coeur et la tête font toujours bon ménage, enfin dans leur meilleur avatar. Unité aussi de soi et du monde, pour le meilleur et pour le pire. C'est un beau voyage de découverte de l'Afrique et du Mali qui nous est offert là.
Mais c'est aussi un voyage dans l'Afrique qui perd sa boussole, qui a perdu ses lois et sa structure et se demande avec angoisse si elle a les moyens d'en acquérir d'autres. Les modèles qu'elle voit autour d'elle ne sont pas très convaincants. Lisez par exemple l'affaire de l'échangeur, une de ces escroqueries couvertes par l'aide au développement. Ou l'affaire des "ogres".
Bien sûr, ce n'est qu'un roman et un très bon, mais il me laisse partagé. Cette compassion qu'il exprime est certainement la clé de toute tentative de rapprochement, d'aide véritable. Et que l'on balaie au passage dans notre propre cour. Mais il nous livre peu de clés pour ouvrir de nouvelles portes. Car celles dont nous disposons, tant le Mali et l'Afrique que nous même, ont échoué. Alors, s'en remettre au sort ? Ne reste-t-il que l'exil, comme semble le conclure ce livre ?
Editions Fayard/Stock (2003)
Page 297 sur 336
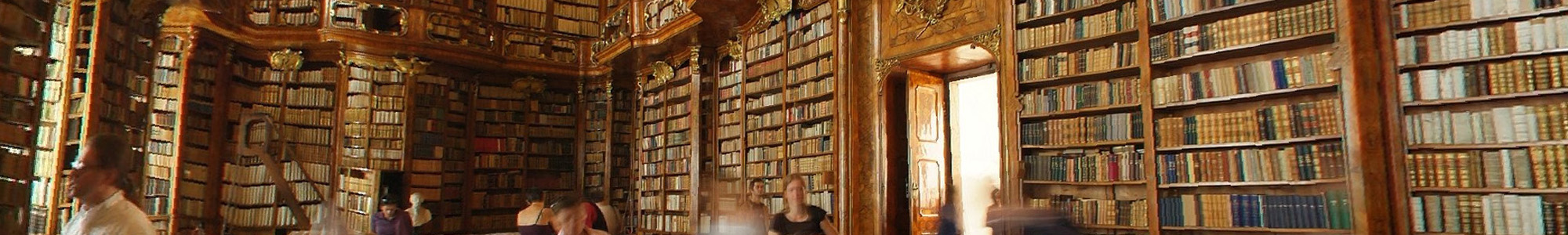


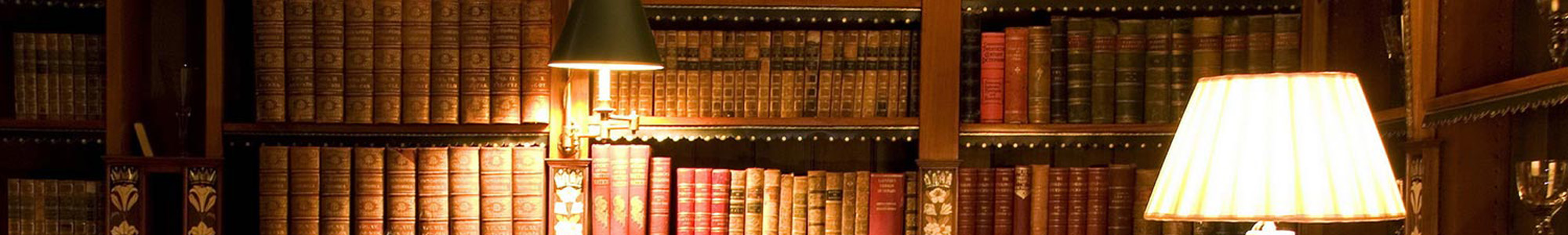

 Conception & réalisation
Conception & réalisation