"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
"Rarum est felix idemque senex" Sénèque
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com

Lire la suite... Michel Didier, Des idées pour la croissance
- Détails
- By livres-et-lectures.com
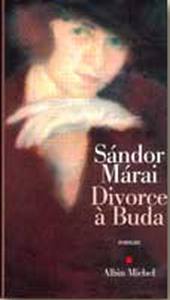 Méfiez vous de vos rêves ! Freud n'est pas loin. Quelqu'un de mes honorables lecteurs pense-t-il que l'amour soit une chose facile ? Qu'il le dise bien vite à SM, car il s'agit pour lui d'une affaire compliquée où les mots cachent la vérité, si tant est qu'elle existe. Ce livre est avant tout un touchant roman de l'imperfection de l'amour et de son partage.
Méfiez vous de vos rêves ! Freud n'est pas loin. Quelqu'un de mes honorables lecteurs pense-t-il que l'amour soit une chose facile ? Qu'il le dise bien vite à SM, car il s'agit pour lui d'une affaire compliquée où les mots cachent la vérité, si tant est qu'elle existe. Ce livre est avant tout un touchant roman de l'imperfection de l'amour et de son partage.
Nous sommes dans le monde hongrois de l'Europe centrale de 1935, un entre-deux guerres où l'on perçoit déjà la suivante sans avoir oublié les horreurs de la première. Un juge doit prononcer dans 24 heures le divorce d'un ancien camarade. Il cherche à juger dans un monde qui devient fou dans ses blocages et il sait qu'il a une mission essentielle dans cette débandade programmée. C'est un des beaux moments de ce livre, que cette méditation sur la difficulté de dire le droit.
Mais l'affaire qu'il doit juger le concerne directement et il vacillera sous les chocs successifs d'une amitié qui ne doit pas le détourner du juste, de rêves obsédants mais maîtrisés et d'une révélation qui aurait pu changer sa vie. Il retrouvera pourtant sa sérénité et le sens de son devoir, tout à son honneur, après une nuit effroyable où tout cela s'enchaîne, face à quelqu'un qui a presque tué et court à son suicide.
Le second personnage, peut-être le plus important, est un pur produit bourgeois de cette société finissante qui a fait la prospérité de ce monde, mais s'est enfermée dans dans des illusions et des croyances qui la stérilisent peu à peu. On pense indirectement au Thomas Mann des "Buddenbrocks". Ce personnage est émouvant dans son déchirement entre ses illusions et la réalité qu'il a découverte. Il est le vivant symbole de cette bourgeoisie déboussolée, comme l'a été celle de Weimar en Allemagne. Comme elle, il se suicidera.
Le style de SM évoque S. Zweig et en particulier "24 heures dans la vie d'une femme". Je n'y retrouve cependant pas la même tension, presque haletante de SZ. De plus SM, comme dans "Les Confessions d'un bourgeois" étire un peu sa phrase et tolère de longues digressions qui émoussent l'intérêt. Ce livre, classique, est néanmoins d'un grand intérêt.
- Détails
- By livres-et-lectures.com
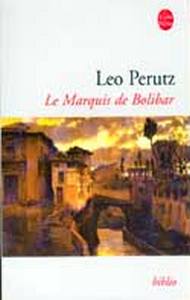
Le roman "Le Cavalier suédois" était de la même veine, plaçant dans un passé déjà éloigné une histoire qui bénéficie de cette façon du brouillard du temps. Et, là aussi, c'est un destin extraordinaire qui trame cette aventure, destin qui conduira le héros narrateur à devenir un autre, à moins que ce soit l'inverse.
Y a-t-il une intention didactique dans ce roman ? Sommes-nous les jouets d'un destin implacable ? L'amour du beau sexe est-il la main cachée de l'enfer ? Je ne crois pas. Il y a avant tout l'intention de nous entraîner dans une histoire forte en utilisant les vieux ressorts qui marchent encore, que ce soit la passion des hommes pour le succès féminin ou pour la guerre ou les craintes millénaires comme l'Antéchrist ou le Démon. Pourquoi pas ?
Ca marche, c'est l'essentiel.
Page 298 sur 336

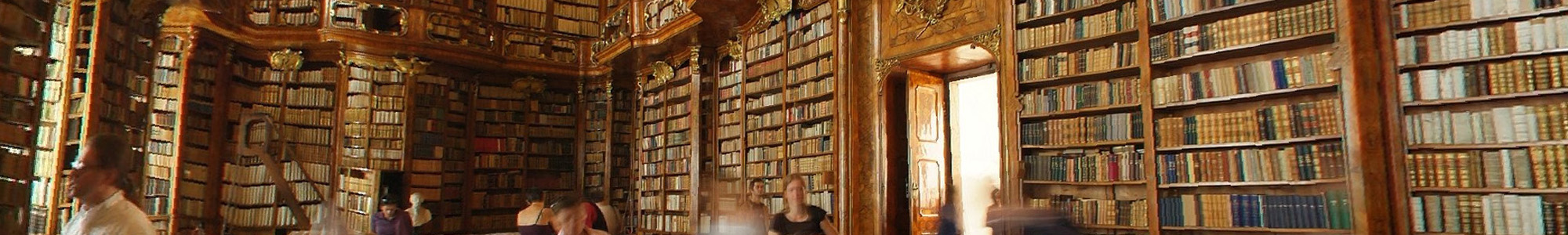
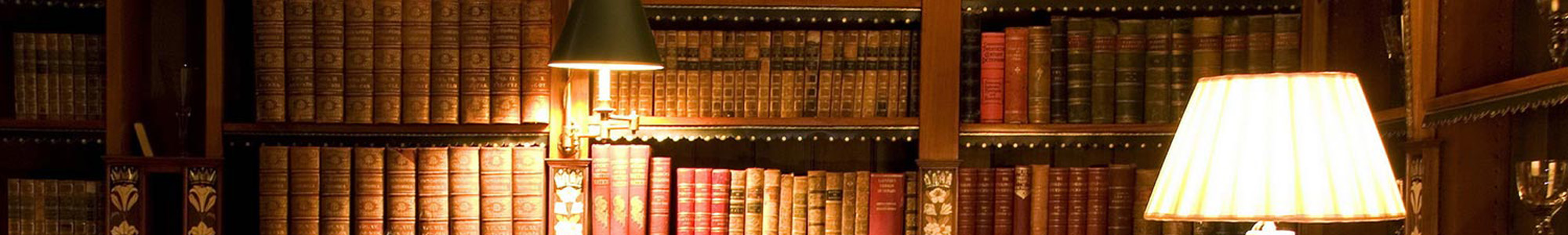


 Conception & réalisation
Conception & réalisation