"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com
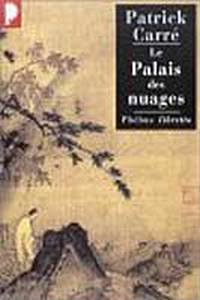 Il faut bien connaître l'histoire chinoise et les valeurs de ce peuple pour écrire avec autant de brio un livre aussi riche et d'une écriture aussi légère et agréable. Une véritable réussite.
Il faut bien connaître l'histoire chinoise et les valeurs de ce peuple pour écrire avec autant de brio un livre aussi riche et d'une écriture aussi légère et agréable. Une véritable réussite.Il s'agit d'un roman historique dont le héros est le narrateur, le dernier empereur chinois des "Songs du Nord" (XII siècle) exilé aux confins de l'empire par les envahisseurs qui l'ont chassé. Il faut aussi savoir que l'époque des "Songs du Nord" a été celle d'admirables réussites en peinture, céramique, poésie et calligraphie en particulier. Un sommet culturel de la Chine en quelque sorte lié à une prospérité considérable, qui devait attirer les "barbares" du Nord. C'est ce que ce roman expose.
Cet empereur avait un rêve : faire de la Chine le royaume de la beauté ! Son entourage profite de cette folie qu'il encourage pour piller l'empire à des fins personnelles. Le gâchis, la gabegie s'installent peu à peu sans que personne ne prenne la mesure des menaces qui pèsent et qui vont se réaliser. Le sens de l'Etat se perd, les caisses se vident et l'inéluctable se produit. Mais n'est ce pas le cycle régulier de l'histoire chinoise qui se déroule là ?
On ne peut qu'être étonné par l'incroyable faiblesse de l'éducation de ce futur empereur isolé dans sa "cité interdite" vivant une existence coupée du monde mais aussi des simples réalités de la vie. Il sera obligé de faire le mur pour découvrir furtivement qu'il existe autre chose que son nid. Ce sera insuffisant pour qu'il acquière un savoir faire, ni même une conscience à la mesure de ses responsabilités. Il sera particulièrement coupable des choix lamentables de ceux à qui il confie les affaires et qu'il élit pour avoir été des compagnons de débauche ou des pourvoyeurs de plaisirs, flattant ses illusions ruineuses. Personnage incompétent et odieux, privé de jugement ou de sentiments, idéologue ès idées folles ! Il conduit son peuple à la misère et à la servitude. La fin paisible qui lui échoit est une injustice de plus dans un destin qui en était tissé.
Et pourtant, les réflexions qu'il fait sur le beau sont parfois des enchantements pour l'esprit. A l'évidence, cela ne suffit pas pour faire un homme et encore moins un empereur.
Ce livre vaut aussi, au delà de la fresque historique, par les multiples fenêtres qu'il ouvre sur la culture chinoise, et en particulier sur le taoisme pour nous souvent fort étrange dans ses principes.
Un livre à recommander chaudement à ceux qui s'interessent, même de loin, à cette civilisation, la plus ancienne de notre planète.
Editions Phébus 2002
- Détails
- By livres-et-lectures.com

APR est un auteur espagnol, né en 1951 et journaliste d'origine. Il a obtenu un prix de littérature policière pour ce livre en 1993.
Cette distinction me paraît tout à fait heureuse, car cette histoire d'escroquerie à l'assurance est remarquablement menée du début à la fin. C'est de plus un livre intelligent qui entrelace une partie d'échec et une plongée dans les dits et les non-dits de la peinture d'une façon magistrale et tout à fait originale. Ici, jamais de recours aux excès délicieux et commerciaux du sexe et de la violence, tout au plus à la manière voilée d'A. Christie.
Aucun des personnages ne va sortir blanc de cette aventure, mais les portraits qui défilent valent le voyage.
Croit-on vraiment à cette intrigue complexe et très "psychologique" ? Assez en tous cas pour passer un bon moment. C'est déjà bien ...
Cette distinction me paraît tout à fait heureuse, car cette histoire d'escroquerie à l'assurance est remarquablement menée du début à la fin. C'est de plus un livre intelligent qui entrelace une partie d'échec et une plongée dans les dits et les non-dits de la peinture d'une façon magistrale et tout à fait originale. Ici, jamais de recours aux excès délicieux et commerciaux du sexe et de la violence, tout au plus à la manière voilée d'A. Christie.
Aucun des personnages ne va sortir blanc de cette aventure, mais les portraits qui défilent valent le voyage.
Croit-on vraiment à cette intrigue complexe et très "psychologique" ? Assez en tous cas pour passer un bon moment. C'est déjà bien ...
Editions Livre de poche 7625 (1990)
- Détails
- By livres-et-lectures.com
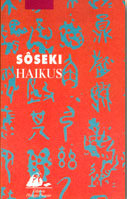
Un haikai est un tout petit outil poétique qui tente d'exprimer dans un éclair allusif plus que ne peuvent signifier les mots qui le composent, plus que ce que les mots ne portent dans leur valeur d'échange. Un peu de ce que nous sentons confusément bouillonner en nous, vaste et inexprimable, confus et si fort. Et tout cela en 17 syllabes, 5-7-5.
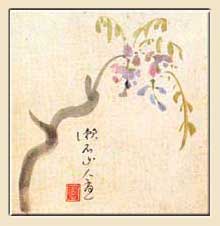
Emoussée la lame
Qui fend la pierre de riz
Emoussée l'année
Journée de printemps qui s'étire
Un baillement entraîne l'autre
Deux amis se quittent
Soseki est un romancier (1867 - 1916) qui continue à être lu, et pas seulement au Japon et à être aimé. Je conserve le souvenir très vif d'un superbe roman "Je suis un chat", ou de "Botchan", par exemple. Mais ici, ce qu'il nous offre est plus intime, plus personnel. Une vraie réussite.
De plus, le livre est magnifiquement mis en page, avec des peintures de l'auteur. Un régal !
De plus, le livre est magnifiquement mis en page, avec des peintures de l'auteur. Un régal !
Editions Philippe Picquier (2001)
Page 296 sur 336

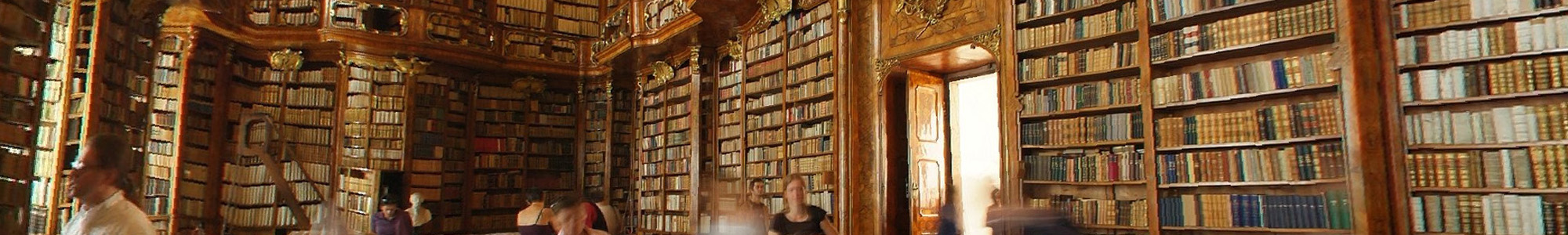

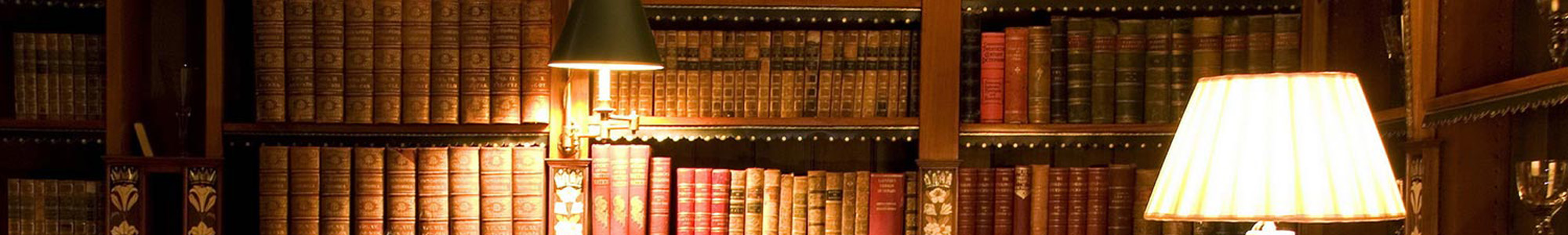

 Conception & réalisation
Conception & réalisation