"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
"Rarum est felix idemque senex" Sénèque
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com

Cet essai expose la multiplicité des influences réciproques des civilisations les unes vis-à-vis des autres au cours de l'histoire récente et le métissage des idées et des concepts qui façonnent les sociétés réelles. Il met aussi en évidence le manque de pertinence des concepts de "guerres de civilisations" ou des fondamentalismes qui cachent la réalité sous des dogmes.
Lire la suite... Jean-Claude Guillebaud, Le commencement d'un monde
- Détails
- By livres-et-lectures.com
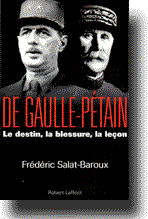
Pendant un quart de siècle, la relation de Gaulle (DG)-Pétain (P) a structuré l'histoire de France. Pas celle du monde, en revanche, que les histoires internes de la France vaincue irritaient plutôt.
Les deux hommes partagent une vision assez proche de la stratégie militaire au début des années 20. Rôle de l'artillerie, rôle de l'aviation, rôle du mouvement, importance de la mobilité, etc. Cela ne suffira pas à faire évoluer la stratégie française, qui, jusqu'à la défaite de 40, sera fondée sur l'attaque par l'infanterie.
- Détails
- By livres-et-lectures.com
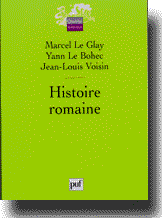 Le monde romain a été pendant près de 1000 ans la matrice de notre Occident. Son histoire est notre histoire et ce manuel, d'une lecture agréable, permet d'en prendre une vision complète.
Le monde romain a été pendant près de 1000 ans la matrice de notre Occident. Son histoire est notre histoire et ce manuel, d'une lecture agréable, permet d'en prendre une vision complète.
Le livre rappelle, à juste titre, combien ce monde romain vit encore en nous : notre langue, nos lois, nos institutions, notre philosophie, etc. Sans négliger tout ce qui, dans notre civilisation, nous caractérise sans que nous en soyons conscients. Nous sommes les lointains rejetons de Cesar, Auguste, Marc-Aurèle, Dioclétien, Hadrien, mais aussi Néron, Elagabale ou Théodose, pour n'en citer que quelques-uns.
Mille ans ( en ne parlant pas de l'Empire byzantin) ! Il est presque incroyable que des institutions, qui ont certes évolué, mais dont la charpente a été stable, aient perduré ainsi. Et ceci, en dépit des coups de bélier que des hommes leur ont donnés, des hommes avides de jouissance et de pouvoir, en lutte entre eux pour ce pouvoir et indifférents à l'avenir de leur civilisation. D'autres, heureusement, avaient une autre carrure et savaient effacer ces errements et rendre à Rome sa puissance.
Il me semble d'ailleurs que l'histoire de Rome nous tend une perche pour comprendre le monde. Que serait-elle devenue sans ces institutions, nombreuses, complexes et évolutives, mais toujours présentes ? Que serait-elle devenue si, au lieu d'institutions politiques organisant la vie de l'empire, Rome avait émergé sous une structure tribale ou clanique, où l'homme est seul et où tout disparaît avec lui ? Cette solidité de Rome fut certes sa force, mais ce fut surtout, à mon avis, son organisation institutionnelle qui garantissait quelque pérennité, au-delà des folies d'hommes remplaçables. Puissent ceux, qui dans le Moyen-Orient de 2011 cherchent une issue à leurs révoltes, se souvenir de cet exemple.
Ce livre est non seulement utile par les faits qu'il rapporte, mais aussi par les pauses fréquentes où il fait un point d'étape sur les changements survenus, dans tous les domaines, de cette civilisation. C'est bien entendu un livre de référence, mais il se lit aussi comme un roman. Une réussite.
Page 190 sur 336

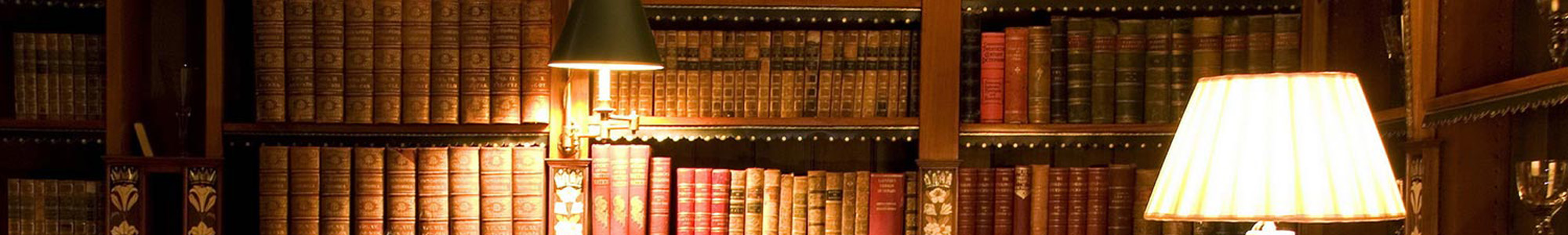
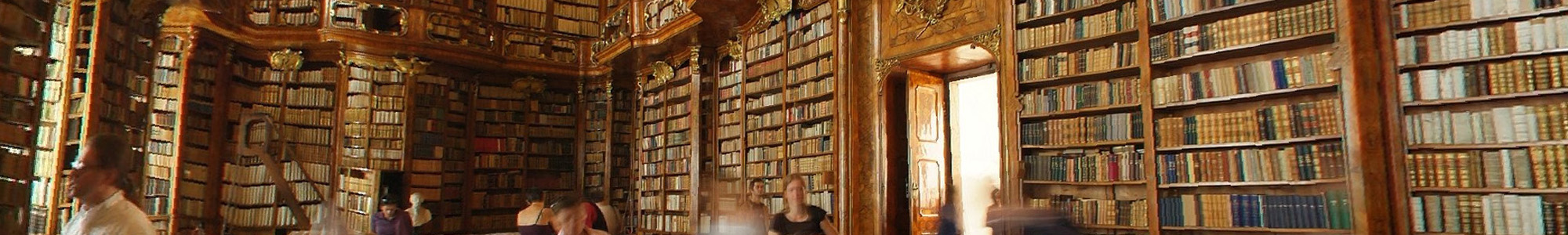


 Conception & réalisation
Conception & réalisation