"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
"Rarum est felix idemque senex" Sénèque
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com
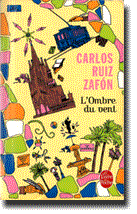
Vous aimez les ombres, les revenants, les morts-vivants, les maisons hantées, tout cela dans le tourbillon d'une affaire rocambolesque et foisonnante dont le fil de l'histoire n'est pas toujours celui d'Ariane ? Jetez-vous dans la lecture de ce roman, ce conte policier pour adultes encore tendres.
Il vous faudra gravir près de 650 pages pour sortir (après bien des dégâts !) du labyrinthe où CRZ nous promène avec une certaine délectation. Les personnages surgissent un peu comme les têtes de l'Hydre de Lerne. Affûtez votre mémoire, si vous ne voulez pas prendre l'un pour l'autre ! Un vrai roman russe, avec la texture espagnole de feu et de sang.
L'histoire se déroule dans Barcelone, ce qui retiendra l'attention de ceux qui connaissent bien la ville. Dans certaines éditions, on livre un petit guide de "Promenades dans Barcelone de l'Ombre du Vent". Bonne idée.
L'intrigue, ou plutôt les intrigues, emboîtées les unes dans les autres se déroulent sur un fond modulé par les troubles sociaux et politiques de l'Espagne devenue franquiste de fraîche date. Les excès, les violences, la désintégration interne, conséquence de ces moments tragiques de guerre civile, sont propices à des situations exceptionnelles que le livre exploite bien.
Pour autant, il me semble qu'en dépit de ses qualités, ce livre est trop long. Mais, après tout, il y a aussi de longues soirées où il n'est pas mauvais de se perdre dans les ennuis des autres pour oublier les siens...
- Détails
- By livres-et-lectures.com
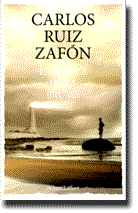
C'est plus un conte qu'un roman. Spectres, magie, pactes infernaux, prouesses physiques, glorification de bons sentiments, etc. On peut aimer. On peut aussi s'y trouver en apesanteur. Surtout si on a perdu son âme d'enfant...
Le livre est facile à lire et agréable. De plus, il est bref.
Mais se laisser emporter dans le rêve par le grand avatar maritime de Lucifer, qui veut son pacte donnant donnant, il faut être aimable lecteur. Il faut aussi être conquis d'avance pour croire aux extraordinaires exploits d'apnée qui nous sont contés.
Et toute cette magie aurait eu grand besoin du talent de Maupassant pour nous convaincre que de telles choses peuvent, dans un glissement insensible du réel, avoir leur poids de vraisemblance.
Si vous ne risquez à peu près rien à lire ce livre, l'inverse est aussi vrai.
- Détails
- By livres-et-lectures.com

Pourquoi n'ai-je pas vraiment aimé ce livre ? Goût du spectaculaire ? Développements psychologiques qui ne me passionnent pas ? Pourtant, il apporte une plongée dans ce Cambodge meurtri que FB connaît bien (voir Le silence du bourreau ou Le Portail) et il nous convie à une prodigieuse découverte de ses moeurs. Mais la beauté est dans l'oeil de celui qui regarde... alors, je ne m'en prends qu'à moi.
L'intrigue est simple : pour ne pas se mettre à dos les populations au moment où le Cambodge bascule sous l'intervention américaine et sous la férule des Khmers Rouges, la représentation française décide de ne pas classer un crime étrange, mais de lancer une investigation approfondie sur lui. Dans ces périodes troublées, seule l'équipe de la "Conservation" de Siem Reap (Angkor) peut encore pénétrer, comme cela s'avère nécessaire, dans les zones reculées de la forêt cambodgienne.
L'aventure commence alors pour une équipe haute en couleurs, accompagnée de deux femmes et d'un guide cambodgiens, qui parviendront au lieu mythique appelé "Le Saut du Varan". En chemin (et quel chemin !), ils s'initieront aux coutumes et aux rituels de peuples presque isolés que l'on croyait disparus et ils résoudront l'énigme du crime, le tout à un prix terriblement élevé. Le livre donne à sentir d'une façon remarquable et bien documentée tant les paysages traversés que l'esprit de ses habitants. Il fallait pour cela toute l'érudition de FB.
Certaines descriptions sont en revanche longues, très longues, plus que ne le supporte mon intérêt, ce qui n'ôte rien à leur valeur. Même remarque pour des analyses psychologiques ou des réflexions à mon goût trop pesantes.
Etant persuadé que ces remarques ne concernent que moi et étant donné que la qualité et l'originalité du récit sont réelles, je recommande donc la lecture du livre à ceux que ce pays, ou simplement l'aventure, intéressent. Ils ne seront pas déçus
Page 186 sur 336
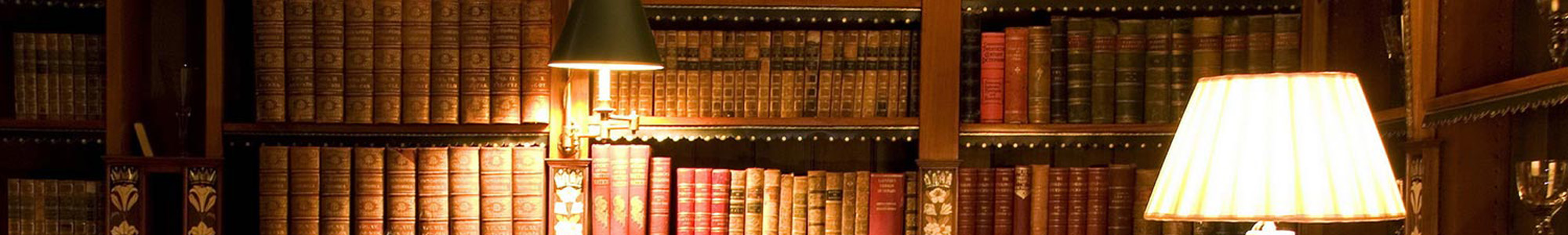



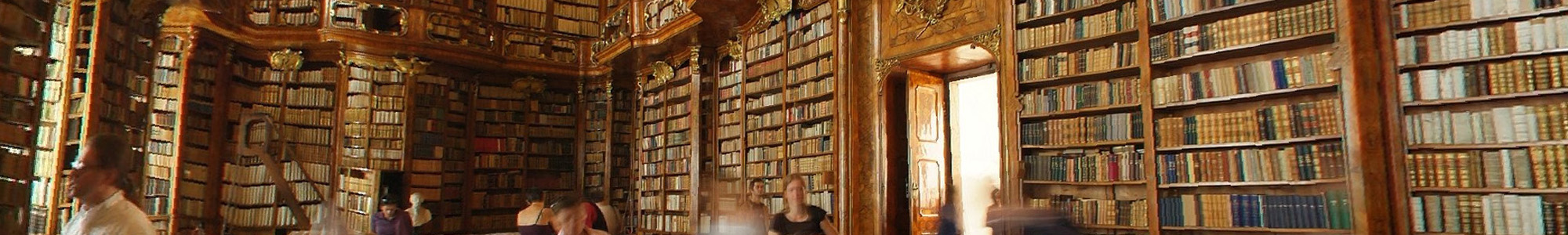
 Conception & réalisation
Conception & réalisation