"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
"Rarum est felix idemque senex" Sénèque
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com
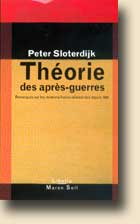
La thèse de PS est simple : les relations franco-allemandes n'existent pas. Cela assure un rapport enfin paisible entre ces deux peuples. On appelle cela l'amitié.
Pourquoi pas ? Cela semble assez bien vu : la fascination jalouse entre les deux peuples qui a dominé leur relation depuis Napoléon a généré beaucoup d'écrits et trois guerres. Mais, depuis 1945, l'intérêt réciproque de nos deux pays décroit, comme le montre la faiblissante référence des deux cultures l'une à l'autre, à commencer par la pratique de la langue.
Lire la suite... Peter Sloterdijk, Théorie des après-guerres
- Détails
- By livres-et-lectures.com

Encore une de ces histoires improbables, mais drôles, que Paasilinna sait mijoter pour notre plaisir.
Un bon pasteur perd la foi, sa femme et ses illusions sur le sens de sa mission, mais il trouve un compagnon presque humain en la personne d'un petit ours dont il va faire un serviteur accompli.
Cette complicité hors norme lui vaudra bien des succès et des découvertes, scientifiques et féminines entre autres et l'aidera à trouver, à son destin, le sens qu'il n'aurait jamais dû perdre ...
Au passage, la vie sociale et ecclésiastique de sa région prend quelques coups de griffes ! Mais, c'est bien normal avec un ours ...
Un excellent remède à la morosité.
- Détails
- By livres-et-lectures.com
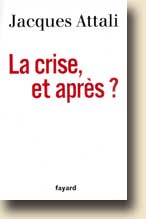
Avec le brillant dont il est coutumier, JA présente ici dans l'urgence sa vision des causes de la crise financière, le déroulement de cette crise et propose des solutions. Mais on le sent pessimiste...
Page 227 sur 336
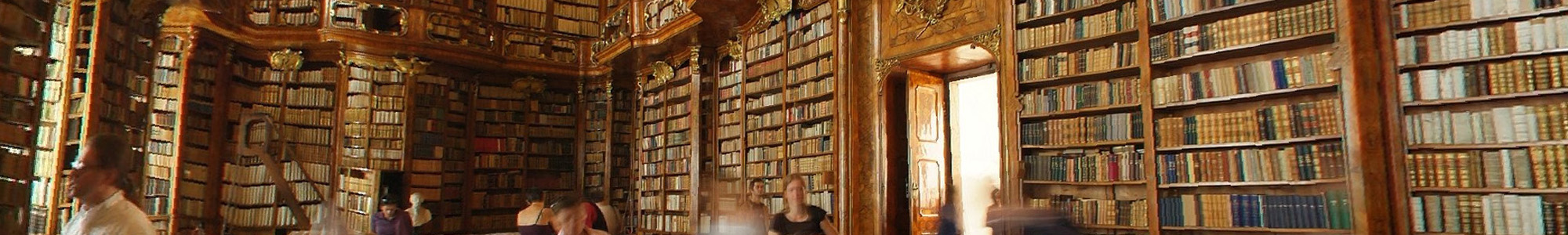



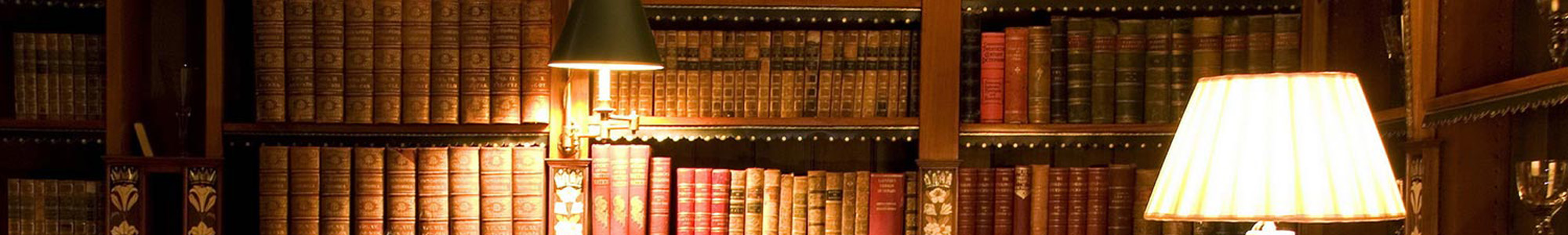
 Conception & réalisation
Conception & réalisation