"Il n'existe qu'une langue pour exprimer des vérités absolues : la langue de bois"
"L'obstination et l'ardeur des opinions sont la preuve la plus sûre de la bêtise" Montaigne, III,8
"Rarum est felix idemque senex" Sénèque
Fiches de lectures, critiques de livres, personnelles et subjectives !
Inscrivez-vous ici pour recevoir l'annonce des nouvelles fiches de lectures
- Détails
- By livres-et-lectures.com
 Il ne s'agit pas du texte de cette épopée indienne, mais d'une adaptation très abrégée, destinée à un lecteur occidental pressé, du Ramayana sanskrit de Valmiki qui compte 24000 vers. Sa lecture en est facile, fidèle me semble-t-il et permet à un public large d'aborder en quelques heures ce monument fondateur de la littérature de l'Inde (avec le Mahabharata) sans en trahir l'esprit.
Il ne s'agit pas du texte de cette épopée indienne, mais d'une adaptation très abrégée, destinée à un lecteur occidental pressé, du Ramayana sanskrit de Valmiki qui compte 24000 vers. Sa lecture en est facile, fidèle me semble-t-il et permet à un public large d'aborder en quelques heures ce monument fondateur de la littérature de l'Inde (avec le Mahabharata) sans en trahir l'esprit.
Le Ramayana aurait été écrit vers l'an 0 en reprenant d'anciennes légendes et récits historiques et n'a pas cessé depuis d'être réédité et modifié. C'est un aventure pleine de bruit, de fureur et d'amour qu'il est hors de question de résumer ici ; mais quelques précisions sont nécessaires pour qu'elle puisse être comprise au delà d'une belle histoire. Car c'est aussi un texte sacré de l'hindouisme (mais qu'est-ce qui n'est pas sacré en Inde ?), montrant comment dieux et hommes sont liés dans la grande loi du monde (le 'dharma) et comment l'homme idéal ici personnifié par Rama doit s'y conformer consciemment.
Dans la pensée de l'Inde, tout d'abord, les actes ont non seulement des conséquences physiques, mais ils entraînent pour celui qui qui en est l'auteur une responsabilité morale que rien ne peut défaire. Les conséquences des actes peuvent être bonnes ou mauvaises parfois même sans que l'auteur en soit conscient. C'est ce qu'on appelle le 'karma', somme de toutes ces charges morales, contrepartie de la liberté de l'homme.
Un autre point qui structure cette pensée est la foi en ce qu'on appelle la réincarnation, qui signifie que tout ce qui naît dans le monde doit assumer ce 'karma' qui conserve dans l'existence un lien individuel avec un être disparu. Et si le poids de ce 'karma' est négatif le nouvel arrivant dans le monde s'incarnera dans une espèce misérable, alors qu'au contraire un karma positif le rapproche d'un objectif de montée progressive dans l'échelle des êtres. Le bouddhisme radicalisera d'ailleurs cette position .
Comment faire, donc, pour améliorer son 'karma' ? C'est ce que nous montre Rama par ses actes d'homme parfait, courageux et compatissant et capable de tenir en respect le mal. Il sait qu'existe la loi du monde, le 'dharma', dans laquelle s'inscrit la loi du bien et celle du mal qui existent par leur opposition et leur lutte permanente. Mais, il disposait d'un avantage considérable, étant lui même un dieu fait homme, un 'avatar' de Vishnu, l'un trois dieux suprêmes de ce panthéon complexe !
La vie indienne et d'une partie de l'Asie est encore de nos jours très influencée par ce récit mythique qui continue à avoir sa place dans la vie quotidienne de ces pays où le sacré et le profane n'ont pas de frontière bien claire. A lire donc par tous ceux que ce monde intéresse !
- Détails
- By livres-et-lectures.com
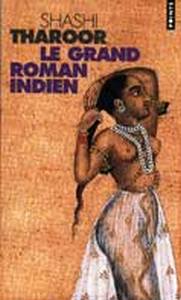 L'auteur est indien, né en 1956 et représente aujourd'hui son pays aux Nations-Unies. Ce premier roman très réussi date de 1993 et a l'originalité (un pari de l'auteur ?) de tenter de dresser une fresque de l'histoire indienne en prenant pour trame le "Mahabharata", épopée mythique de l'Inde. Rassurons tout de suite ceux qui ne la connaissent pas, car le livre se suffit à lui seul.
L'auteur est indien, né en 1956 et représente aujourd'hui son pays aux Nations-Unies. Ce premier roman très réussi date de 1993 et a l'originalité (un pari de l'auteur ?) de tenter de dresser une fresque de l'histoire indienne en prenant pour trame le "Mahabharata", épopée mythique de l'Inde. Rassurons tout de suite ceux qui ne la connaissent pas, car le livre se suffit à lui seul.
Cette histoire indienne se déroule sur une longue période qui va de la colonie anglaise aux années 80, peu avant l'assassinat d'Indira Gandhi, la fille de Nehru. L'unité du ton est assurée par le récit que fait un vieux politicien qui a tout vu et tout connu et a acquis de ce fait, non seulement la vision globale et cohérente qu'il nous livre, mais aussi un détachement souvent ironique vis à vis du monde qu'il décrit. Détaché, certes, mais sans jamais laisser sa passion pour son pays s'éloigner de son coeur, celle de l'auteur aussi, sans doute. Peu à peu émergent de cette lecture très riche quelques grands enseignements.
D'abord, l'Inde est le plus grand essai d'appliquer la démocratie à un pays immense pauvre et très inégalitaire et dont le moins qu'on puisse dire est que les structures mentales n'étaient pas moulées par les idées du siècle des "lumières" ! La méthode qu'utilisa Gandhi fut terriblement originale, mais a fonctionné et a abouti à une situation viable, spécifique à ce pays en dépit de terribles heurts. C'est aussi l'espoir de voir ceux qui vivent encore dans des structures tribales, souvent déguisées d'ailleurs, entrer un jour dans le monde moderne, pour peu qu'il trouvent eux aussi leur méthode et leur Gandhi.
Ensuite, notre conteur nous fait bien comprendre que l'histoire est faite par les hommes, comme lui et nous, avec leurs forces et leurs faiblesses. Rien n'est écrit, rien n'est du, tout est fragile. Les hommes n'ont que les droits qu'ils conquièrent et défendent. Ni plus, ni moins.
Enfin, ce parallèle avec un grand récit mythique fondateur, le "Mahabharata", nous rappelle combien les mythes peuvent être forts et structurants et aider à donner un sens aux choses, là où, peut-être, il n'y en a pas beaucoup. Ainsi cette histoire moderne, en partie empruntée à la pensée politique occidentale redevient indienne, ce qu'elle est absolument, unique, spécifique et pourtant universelle parce qu'humaine. Le Ganga Datta ou Gangaji du récit (Gandhi) n'est-il pas un vrai personnage mythique ?
Un très grand roman, vivant, humain drôle et touchant. Existe-t-il une meilleure façon de connaître et peut-être comprendre ce grand pays ?
Éditions Points P 1047
- Détails
- By livres-et-lectures.com
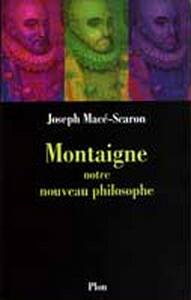 Ce livre est un rappel opportun de ce qu'il y a de contemporain et surtout d'actuel dans Montaigne. J'allais dire 'dans la pensée de Montaigne' et c'est bien, tout compte fait, ce qu'il ne faut pas dire ! Sa vie, ses actes, ses remarques sur les événements dont il est spectateur et acteur comptent plus que la tentative, à mon sens vouée à l'échec, de bâtir un 'système philosophique' à partir des "Essais". Comme le dit l'auteur : "Platon pensait que les choses sensibles étaient des copies plus ou moins brouillées des idées qui étaient, elles, les véritables originaux. Montaigne serait plutôt d'avis contraire". La diversité du monde en fait la richesse.
Ce livre est un rappel opportun de ce qu'il y a de contemporain et surtout d'actuel dans Montaigne. J'allais dire 'dans la pensée de Montaigne' et c'est bien, tout compte fait, ce qu'il ne faut pas dire ! Sa vie, ses actes, ses remarques sur les événements dont il est spectateur et acteur comptent plus que la tentative, à mon sens vouée à l'échec, de bâtir un 'système philosophique' à partir des "Essais". Comme le dit l'auteur : "Platon pensait que les choses sensibles étaient des copies plus ou moins brouillées des idées qui étaient, elles, les véritables originaux. Montaigne serait plutôt d'avis contraire". La diversité du monde en fait la richesse.
Nous cheminons tout au long de ce livre en compagnie d'un homme dont le modèle semble aujourd'hui un peu perdu. Un homme qui au cours des terribles guerres de religion du 16ème siècle a pu voir que 'ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude'. Nous en avons encore chaque jour la preuve, et les religions n'y contribuent pas pour rien. Montaigne est un homme engagé dans la vie où il jouera un rôle politique significatif, mais qui ne se donne jamais sans se réserver à soi-même : "Nous nous devons en partie à la société, mais en la meilleurs partie à nous". Il se présente aussi comme un conservateur, c'est à dire celui qui se demande ce qu'il doit transmettre à ceux qui le suivent. La fragilité des sociétés, bien ébranlées en son siècle, l'incline à préférer un ordre acceptable à la recherche révolutionnaire d'absolus de liberté ou de justice, par exemple, qu'il estime inaccessibles sans un risque d'explosion. Notre beau 20ème siècle n'a-t-il pas confirmé cette analyse ?
Moins raide qu'un stoïcien, moins épris de système qu'un épicurien, Montaigne n'a pas oublié leur leçon. Il est avant tout un homme attaché au présent, creuset du passage, qu'il nous invite à vivre pleinement, avec bonheur et modestement. Il est sceptique, mais agit et sait que sa raison ne lui donne dans le monde qu'un avantage de circonstance. "Si j'avais à revivre, je revivrais comme j'ai vécu ; ni je ne plains le passé, ni je ne crains l'avenir".
C'est à cette redécouverte familière que nous invite ce livre réussi, à une plongée amicale dans cette sagesse foisonnante et sans rupture, d'apparence simple mais riche et qui fait aujourd'hui bien défaut dans la conduite de nos vies. Relisons les "Essais" !
Éditions Plon (2002)
Page 304 sur 336



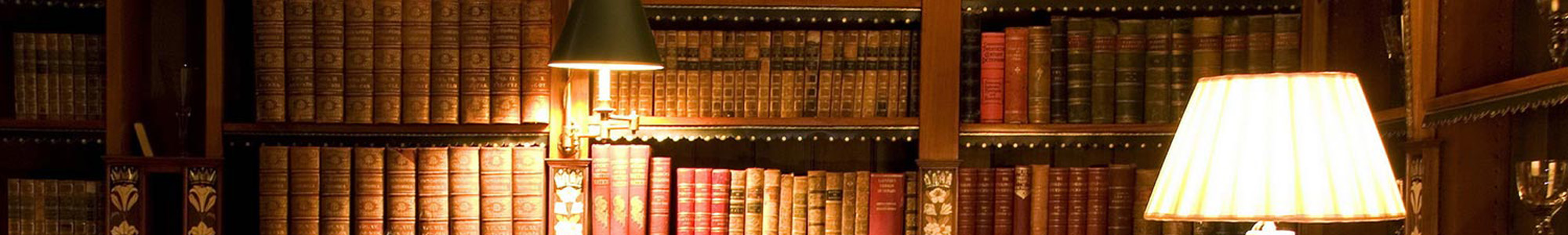
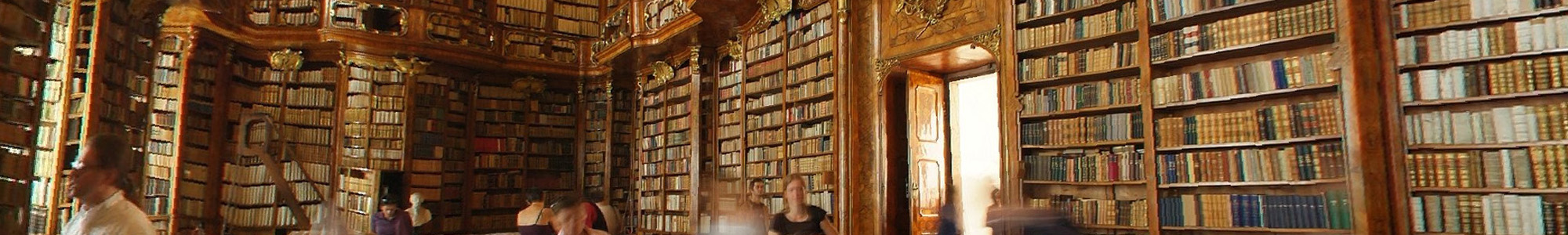
 Conception & réalisation
Conception & réalisation